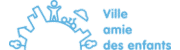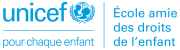En dépit d’un contexte défavorable, les pays doivent renouveler leur engagement à lutter contre la mortalité maternelle.
Genève/New York, le 7 avril 2025 – D’après un nouveau rapport, les femmes ont aujourd’hui plus de chances que jamais de survivre à leur grossesse et à leur accouchement. Cependant, les agences des Nations Unies (ONU) soulignent le risque d’un recul majeur alors que des coupes budgétaires sans précédent dans l’aide humanitaire se multiplient à travers le monde.
Publié à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le rapport des Nations unies intitulé « Tendances en matière de mortalité maternelle« , indique une baisse mondiale de 40 % des décès maternels entre 2000 et 2023, principalement attribuable à un meilleur accès aux services de santé essentiels. Cependant, le rapport révèle que les progrès ont considérablement ralenti depuis 2016 et qu’environ 260 000 femmes sont décédées en 2023 des suites de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, ce qui représente environ un décès maternel toutes les deux minutes.
Les coupes budgétaires menacent la survie des mères et nourrissons les plus vulnérables
Ce rapport paraît au moment même où les coupes budgétaires dans l’aide humanitaire affectent gravement les services de santé essentiels dans de nombreuses régions du monde, obligeant les pays à réduire les soins vitaux pour les mères, les nouveau-nés et les enfants. Ces coupes ont entraîné la fermeture d’établissements et la réduction des effectifs de personnel soignant, mais aussi la rupture des chaînes d’approvisionnement en fournitures et médicaments essentiels, tels que les traitements contre les hémorragies, la pré-éclampsie et le paludisme, qui sont les principales causes de mortalité maternelle.
Sans mesures urgentes, les agences onusiennes prévoient de graves répercussions pour les femmes enceintes dans de nombreux pays, en particulier dans les zones de crise humanitaire où le taux de mortalité maternelle est déjà alarmant.
« Si ce rapport laisse entrevoir une lueur d’espoir, les données mettent aussi en évidence le danger que représente encore aujourd’hui la grossesse dans une large partie du monde, alors qu’il existe des solutions pour prévenir et traiter les complications à l’origine de la grande majorité des décès maternels », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « En plus de garantir l’accès à des soins obstétricaux de qualité, il sera essentiel de renforcer les droits fondamentaux des femmes et des filles en matière de santé et de procréation, facteurs qui conditionnent largement l’évolution de leur grossesse et leur santé future ».
Assurer la continuité des soins obstétricaux en toutes circonstances
Ce rapport dresse également le premier état des lieux mondial de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la survie maternelle. En 2021, on estime que 40 000 femmes supplémentaires sont décédées des suites d’une grossesse ou d’un accouchement, passant de 282 000 l’année précédente à 322 000. Cette recrudescence est liée non seulement aux complications directes causées par la COVID-19, mais aussi aux interruptions généralisées des services de maternité. Cela souligne l’importance de garantir la continuité de ces soins pendant les pandémies et autres situations d’urgence, car les femmes enceintes ont besoin de pouvoir accéder en toute fiabilité aux services et contrôles de routine, ainsi qu’à des soins d’urgence 24 heures sur 24.
« Lorsqu’une mère décède pendant sa grossesse ou son accouchement, la vie de son bébé est également en danger. Bien trop souvent, les deux périssent de causes que nous sommes pourtant en mesure de prévenir », a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF. « Les coupes budgétaires mondiales affectant les services de santé mettent davantage de femmes enceintes en danger, en particulier dans les régions les plus fragiles, en limitant leur accès aux soins essentiels pendant la grossesse et au soutien dont elles ont besoin lors de l’accouchement. Le monde doit investir de toute urgence dans les sages-femmes, maïeuticiens, infirmières, infirmiers et agents de santé communautaires afin de garantir à chaque mère et à chaque bébé une chance de survivre et de s’épanouir ».
De grandes disparités géographiques persistent
Le rapport met en évidence les inégalités persistantes entre les régions et les pays, ainsi que les progrès inégaux. Avec une baisse de la mortalité maternelle d’environ 40 % entre 2000 et 2023, l’Afrique subsaharienne a réalisé des progrès significatifs – et a été l’une des trois seules régions (tels que définies par les Nations unies), avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et l’Asie centrale et du Sud – à connaître une baisse significative après 2015. Cependant, confrontée à des taux de pauvreté élevés et à de multiples conflits, la région de l’Afrique subsaharienne comptait encore pour environ 70 % du nombre de décès maternels dans le monde en 2023.
Témoignant d’un ralentissement des progrès, la mortalité maternelle a stagné dans 5 régions après 2015 : l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale, l’Asie de l’Est et du Sud-Est, l’Océanie (à l’exclusion de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande), l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes.
« L’accès à des services de santé maternelle de qualité est un droit, pas un privilège, et nous partageons tous la responsabilité impérieuse de mettre en place des systèmes de santé dotés de ressources suffisantes pour protéger la vie de chaque femme enceinte et de chaque nouveau-né », a déclaré le Dr Natalia Kanem, directrice exécutive du FNUAP. « En renforçant les chaînes d’approvisionnement, le corps médical spécialisé en obstétrique et les données désagrégées nécessaires pour identifier les personnes les plus à risque, nous pouvons et nous devons mettre un terme au drame des décès maternels évitables et à leur terrible impact sur les familles et les sociétés ».
Selon ce rapport, les femmes enceintes affectées par les urgences humanitaires sont confrontées à certains des risques parmi les plus élevés au monde. Près des deux tiers des décès maternels dans le monde surviennent aujourd’hui dans des pays en situation de fragilité ou de conflit. Pour les femmes qui vivent dans ces contextes, les risques sont considérables : une jeune fille de 15 ans a 1 chance sur 51 de mourir de complications liées à la grossesse au cours de sa vie, contre 1 chance sur 593 dans les pays plus stables. Le Tchad et la République centrafricaine sont les pays où le risque de décès est le plus élevé (1 sur 24), suivis du Nigeria (1 sur 25), de la Somalie (1 sur 30) et de l’Afghanistan (1 sur 40).
Améliorer la santé globale des femmes au-delà de la grossesse
Au-delà de la nécessité d’assurer les services essentiels pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, le rapport souligne l’importance des efforts visant à améliorer la santé globale des femmes en facilitant l’accès aux services de planification familiale, ainsi qu’en prévenant les problèmes de santé sous-jacents tels que l’anémie, le paludisme et les maladies non transmissibles qui augmentent les risques. Il sera également essentiel de veiller à ce que les filles restent scolarisées et que les femmes et les filles disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour prendre soin de leur santé.
Des investissements urgents sont nécessaires pour prévenir la mortalité maternelle. Le monde est actuellement en retard par rapport à l’objectif de développement durable des Nations unies en matière de survie maternelle. À l’échelle mondiale, le taux de mortalité maternelle devrait diminuer d’environ 15 % chaque année pour atteindre l’objectif fixé pour 2030, ce qui représente une accélération significative si l’on considère le taux actuel de déclin annuel d’environ 1,5 %.
Télécharger le rapport complet ICI.
Télécharger les contenus multimédias ICI.
Notes aux rédactions :
Définition : Un décès maternel est un décès dû à des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, survenant lorsqu’une femme est enceinte ou dans les six semaines suivant la fin de sa grossesse.
À propos des données : L’objectif de développement durable (ODD) en matière de survie maternelle consiste à atteindre un taux de mortalité maternelle mondial (TMM) inférieur à 70 décès maternels pour 100 000 naissances viables d’ici 2030. Le taux de mortalité maternelle mondial en 2023 était estimé à 197 décès maternels pour 100 000 naissances viables, contre 211 en 2020 et 328 en 2000.
Le rapport comprend des données réparties par régions, telles qu’utilisées pour les rapports relatifs aux ODD : Asie centrale et Asie du Sud ; Afrique subsaharienne ; Amérique du Nord et Europe ; Amérique latine et Caraïbes ; Asie occidentale et Afrique du Nord ; Australie et Nouvelle-Zélande ; Asie de l’Est et Asie du Sud-Est ; et Océanie, à l’exclusion de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
À propos de la Journée Mondiale de la Santé : La Journée Mondiale de la Santé est célébrée dans le monde entier le 7 avril. Chaque année, elle attire l’attention sur un sujet de santé spécifique qui préoccupe les populations du monde. La « Journée Mondiale de la Santé 2025 » a pour thème « Healthy beginnings, hopeful futures », et vise à améliorer la santé et la survie des mères et des nouveau-nés. Elle appelle les gouvernements et les professionnels de santé à redoubler d’efforts pour mettre fin aux décès évitables de mères et de nouveau-nés, et à donner la priorité à la santé et au bien-être des femmes à long terme.
À propos du Groupe Inter-agences des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité maternelle (IGME) : Ce rapport a été produit par l’OMS au nom du Groupe Inter-agences des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité maternelle, regroupant l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP, le Groupe de la Banque mondiale et la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Il s’appuie sur des données nationales pour estimer les niveaux et les tendances de la mortalité maternelle entre 2000 et 2023. Les données de cette nouvelle étude couvrent 195 pays et territoires. Elles remplacent toutes les estimations précédentes publiées par l’OMS et l’IGME.